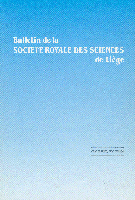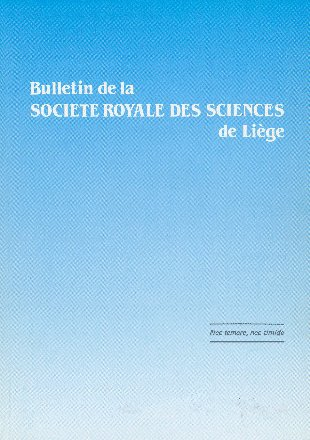- Accueil
- Volume 94 - Année 2025
- No 2 - Colloque Annuel 2025: L'art au service de l...
- Léonard de Vinci, savant aux connaissances universelles ?
Visualisation(s): 141 (6 ULiège)
Téléchargement(s): 46 (0 ULiège)
Léonard de Vinci, savant aux connaissances universelles ?

Document(s) associé(s)
Version PDF originaleTable des matières
Manuscrit reçu le 17 novembre 2025 et accepté le 19 novembre 2025
Article publié selon les termes et conditions de la licence Creative Commons CC BY 4.0.
Communication invitée présentée au colloque annuel de la Société Royale des Sciences de Liège sur « L’art au service de la science, la science au service de l’art », Université de Liège (Belgique), 28 novembre 2025.
Léonard de Vinci, savant aux connaissances universelles ?
1Au folio 327v du Codex Atlanticus—un ensemble hétéroclite de textes et de dessins de la main de Léonard de Vinci (1452–1519), montés à la fin du xvie siècle dans un recueil de grand format—on trouve les considérations suivantes :
Je sais bien, n’étant pas moi un lettré, eh bien que certains présomptueux croient pouvoir me blâmer en invoquant que je suis un « homme sans lettres ». Pauvres fous, ils ne savent pas ceux-là, que moi je pourrais leur répondre—comme Marius répondit aux patriciens romains—en disant : « ceux qui se vantent des exploits d’autrui sont les mêmes qui ne veulent pas reconnaître, à moi, les miens ». Ils diront aussi que, manquant de lettres, je ne suis pas capable de bien dire ce que je veux traiter. Or, ils ne savent pas ceux-là que mes choses sont tirées de l’expérience plutôt que de la parole d’autrui, laquelle fut maîtresse de tous ceux qui ont bien écrit, et ainsi je la prends comme maîtresse et, elle, je l’invoquerai en toute situation.1
2Dans ces lignes, rédigées aux environs de 1487, Léonard se qualifie d’« omo sanza lettere », c’est-à-dire ignorant le latin et les lettres classiques. Toutefois, de façon contradictoire, il le fait avec érudition : il cite un certain Marius en empruntant un passage du Bellum Jugurthinum de Salluste qu’il connaît d’après le De Re militari de Roberto Valturio, l’un de ses ouvrages préférés, lu dans la version italienne de Paolo Ramusio [1, p. 36]. Homme inculte, Léonard ne l’était qu’en partie : à force de s’exercer, de lire, de fréquenter des savants de son temps, et, surtout, de confronter ses connaissances à l’expérimentation, il était devenu un « omo universale », dans le sens d’une personnalité dont les connaissances et les compétences s’appliquent à des sujets d’une grande diversité. La curiosité de Léonard est insatiable. Elle s’applique à des domaines variés, de la physique, à l’optique, à la botanique, en passant par la géologie, l’hydrodynamie, la résistance des matériaux, mais aussi le vol des oiseaux, l’anatomie, l’astronomie, ou encore la propagation de la lumière ou du son, l’architecture, … Comme le révèle le passage du Codex Atlanticus qui vient d’être mentionné, la science de Léonard se révèle aussi, à ses yeux du moins, plus exacte que celle produite par certains de ses contemporains : elle repose sur l’observation et l’expérience directe des phénomènes, et non sur la seule lecture de considérations avancées et répétées par d’autres [2, p. 73]. Ceci ne signifie pas que Léonard a assimilé le savoir facilement : ses aptitudes ne sont pas innées, elles sont le fruit d’un travail long et acharné. Ceci ne signifie pas non plus que le maître peut être considéré comme un précurseur de la science moderne. D’abord, le Florentin n’a pas toujours mené à bien les expériences qu’il décrit dans ses notes et ses dessins. Ensuite, la plupart du temps, Léonard observe un phénomène aux fins de conforter une certitude décrite par la théorie, l’expérience s’apparentant dès lors plutôt à une mise à l’épreuve de ladite théorie [3, p. 226–227]. Mais reprenons. Est-il possible d’expliciter plus avant ces deux qualifications, celle d’un Léonard, « omo sanza lettere », revendiquée par le Florentin lui-même, et celle d’un Léonard, « omo universale » ? Surtout, est-il possible de réconcilier ces deux portraits ?
3Si Léonard peut être qualifié d’« omo universale », il est aussi justifié de le définir comme un « omo sanza lettere ». Sa formation intellectuelle n’est pas celle des savants et des érudits de l’époque. Puisque Léonard est un fils illégitime (il est l’enfant de ser Piero da Vinci, jeune notaire dont la renommée grandissait à Florence, et d’une dénommée Caterina, dont on a récemment présumé qu’elle était une esclave, originaire du Caucase), il n’a pas fréquenté l’université. Selon toute vraisemblance, on ne lui enseigna pas non plus des rudiments de notariat, une activité que les Vinci exerçaient depuis plusieurs générations : l’activité est alors réservée aux seuls enfants légitimes, comme le précise une disposition de l’Arte dei Giudici (juges) e dei Notai (notaires) [4, p. 25]. En 1462 ou 1463, alors qu’il est âgé d’une dizaine d’années, Léonard rejoint son père à Florence. Il y fréquente une école d’abaco, une école privée d’arithmétique, dans laquelle sont délivrées des leçons de raisonnement et de mathématique, appliquées aux besoins concrets des marchands, nombreux à Florence, mais aussi un enseignement moral et religieux [1, p. 39]. Ensuite, vers 1463–1465, Léonard entre en apprentissage dans l’atelier d’Andrea del Verrocchio (1434/1437–1488), qui, outre la sculpture et l’orfèvrerie, pratique aussi l’activité de peintre. Léonard y apprend les bases d’un métier ; Verrocchio lui transmet, non un savoir théorique, mais un savoir-faire pratique.
4Puisque Léonard n’a pas fréquenté une école di lettere, qui elle-même prépare au cursus universitaire, il n’a pas lu (dans sa jeunesse) les textes des grands auteurs passés, qu’ils soient antiques ou médiévaux. Surtout, il n’a pas appris le latin, la rhétorique, la poésie, l’histoire ou la philosophie. Cette situation est habituelle pour la plupart des artistes et des artisans du xve siècle. Aux yeux de Léonard, elle constitue un obstacle à contourner. À partir de la fin des années 1480, à presque quarante ans, l’artiste estime en effet que son ignorance du latin—qui sert alors de support quasi-exclusif à la science et qui est la langue des érudits—porte à conséquence [1, p. 40 ; 2, p. 258 ; 5 ; 6, p. 112–116]. Il se lance alors dans la quête d’un savoir plus vaste, avec obstination et persévérance, et ce spécialement dans les domaines linguistique et mathématique. Cette quête passe d’abord et avant tout par l’apprentissage du latin. Le Florentin acquiert des grammaires latines (comme les Rudimenta grammatices de Niccolò Perotti), des dictionnaires et des lexiques. Il poursuit son apprentissage par la pratique, comme en témoigne le Codex Trivulziano, dans lequel on trouve des listes interminables de mots en latin et en toscan savant. Léonard les recopie en colonne et consigne leur traduction en langue vulgaire, se confectionnant ainsi des dictionnaires personnels qui lui permettront de maîtriser avec plus de précision des termes abstraits, éloignés du vocabulaire concret de son milieu d’origine, celui des marchands et des artisans. Au-delà de l’apprentissage du latin, l’objectif de Léonard est donc aussi de parfaire son usage de la langue vulgaire. Apprendre de nouveaux mots, définir avec rigueur et précision les dispositifs dont on entend rendre compte, s’entendre sur la terminologie, autant de défis qui demandent une maîtrise fine du langage. En fait, une fois installé à Milan, à la cour savante de Ludovic Sforza, l’une des ambitions du maître est celle de devenir un « scrittore », un « altore », comme il le dit lui-même, c’est-à-dire un écrivain, un auteur de livres et de traités [5, p. 113–114 ; 7, p. 16–17]. Cette détermination à mieux maîtriser le latin et la langue vulgaire passe encore par la lecture et l’acquisition d’ouvrages. À partir de la fin des années 1480, Léonard commence à consulter et à acheter des livres, rassemblant ainsi une vaste et importante bibliothèque personnelle [1, p. 37 ; 8–13]. Cet ensemble ne nous est pas parvenu ; après la mort de Léonard, il sera dispersé. Il est néanmoins possible de le restituer, et ce en compilant les listes de livres que le maître confectionne sa vie durant, au moment de ses déménagements par exemple, mais aussi en répertoriant des mentions ou des échos d’ouvrages spécifiques dans ses écrits. La bibliothèque de Léonard ne peut être comparée aux collections des grands intellectuels du temps : le Florentin se concentre peu sur les disciplines qui suscitent alors l’intérêt des érudits de haut vol, comme la philosophie, la théologie, l’histoire, la littérature antique. Il n’empêche, cet ensemble est exceptionnel tant en raison du nombre important de volumes qui la composait que de la diversité des sujets abordés. À la fin de la vie du maître, on estime que sa bibliothèque devait compter 200 ouvrages environs, un chiffre important si on le compare au nombre de livres que possédaient les ingénieurs, les architectes et les artistes de l’époque. C’est aussi, et surtout, une bibliothèque d’une variété remarquable. Elle couvre un très large spectre disciplinaire, témoignant ainsi, de façon privilégiée, de la curiosité insatiable de Léonard et de son universalité. En effet, habituellement, les bibliothèques privées du temps rassemblent des ouvrages dédiés à une seule et unique discipline, en lien étroit avec la profession exercée par le propriétaire (les médecins possèdent des livres de médecine, les hommes de loi ceux relatifs au droit, …). Rares sont alors les bibliothèques privées qui réunissent deux ou trois domaines du savoir et, plus exceptionnelles encore, celles qui relèvent, comme dans ce cas, de cinq, six ou sept domaines de spécialité. Le Florentin possédait en effet des ouvrages relevant de la littérature antique et contemporaine (profane et dévotionnelle), de la langue (grammaire, rhétorique, manuels de style), de la philosophie et de la religion, des sciences et des techniques (ouvrages de mathématiques, d’art de la guerre, d’agriculture, de chirurgie, de droit, de musique, de chiromancie, de gemmologie).
5En somme, Léonard peut être autant qualifié d’homme sans lettres (du moins au début de sa carrière) que d’homme universel : alors même qu’il n’a pas suivi un parcours scolaire poussé et à force d’un travail obstiné, le Florentin est devenu un savant aux connaissances multiples. Une telle réputation se reflète aussi dans les portraits du maître : la plupart—comme le dessin du Turin (inv. 15571), longtemps considéré comme un autoportrait, aujourd’hui plutôt interprété comme un portrait de vieillard, ou la feuille de Windsor (RCIN 912726), aujourd’hui attribuée à Francesco Melzi, l’un des disciples de Léonard—le présentent avec une barbe fournie et des cheveux longs. Or, il s’agit là de signes qui distinguent les gens de savoir [14, p. 55–63]. Ces images présentent d’ailleurs d’étroites affinités avec les portraits qui circulent alors du philosophe par excellence, Aristote [1, p. 28–33 ; 15, p. 112]. Les premiers biographes du Florentin sont aussi nombreux à insister sur le fait qu’il ressemblait à un philosophe antique ou à un druide. C’est le cas de Gian Paolo Lomazzo qui, en 1590, dans son Idea del tempio della pittura, rapporte que le maître « avait un visage avec des cheveux longs et les sourcils et la barbe si longs qu’il incarnait la véritable noblesse de l’étude, comme jadis le druide Hermès ou l’antique Prométhée ».2 Fils illégitime et homme sans lettres, Léonard est devenu, au fil du temps, un « omo universale », un intellectuel décidé à se confronter aux auteurs du passé mais aussi aux savants contemporains. Plus de cinq cents ans après sa mort, son universalité et son insatiable curiosité fascinent encore.
Informations supplémentaires
Conflits d’intérêt
6L’autrice déclare qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt.
Notes
1 “So bene che, per non essere io letterato, che alcuni prosuntuosi gli parrà ragionevolmente potermi biasimare coll’allegare io essere omo sanza lettere. Gente stolta, non sanno questi tali ch’io potrei, sì come Mario rispose contro a’ patrizi romani, io sì rispondere, dicendo: quelli che dall’altrui fatiche se medesimi fanno ornati, le mie a me medesimo non vogliano concedere. Diranno che, per avere io lettere, non potere ben dire quello di che volgio trattare. Or non sanno questi che le mie cose son più da essere tratte dalla sperienzia, che d’altrui parola, la quale fu maestra di chi bene scrisse, e così per maestra la piglio e quella in tutti i casi allegherò.” La traduction française est de Stefania Tullio Cataldo que je remercie.
2 “[H]ebbe la faccia con li capelli longi, con le ciglia, et con la barba tanto longa, che egli pareva la vera nobilità del studio, quale fu già altre volte il Druidio Hermere o l’antico Prometeo”. [16]
Bibliographie
[1] Arasse, D. (2003) Léonard de Vinci : Le rythme du monde. Hazan, Paris. (Éd. originale Paris, 1997).
[2] Nicholl, C. (2006) Léonard de Vinci. Biographie. Actes Sud, Arles.
[3] Brioist, P. (2019) Les audaces de Léonard de Vinci. Stock, Paris.
[4] Cursi, M. (2019) Scrittura e scritture nel mondo di Leonardo. Dans Leonardo e i suoi libri. La biblioteca del genio universale, édité par Vecce, C., pages 25–31. Giunti, Florence.
[5] Frosini, F. (2006) Nello studio di Leonardo. Dans La mente di Leonardo. Nel laboratorio del genio universale, édité par Galluzzi, P., pages 113–126. Giunti, Florence.
[6] Vecce, C. (2019) Léonard de Vinci. Flammarion, Paris. (Éd. originale : Rome, 1998).
[7] Vecce, C. (2019) Leonardo e i suoi libri. Dans Leonardo e i suoi libri : La biblioteca del genio universale, édité par Vecce, C., pages 13–23. Giunti, Florence.
[8] Dionisotti, C. (1962) Leonardo uomo di lettere. Italia medioevale e umanistica, 5, 183–216.
[9] Marinoni, A. (1987) La biblioteca di Leonardo. Raccolta Vinciana, 22, 291–342.
[10] Villata, E. (2009) La biblioteca, il tempo e gli amici di Leonardo : disegni di Leonardo dal Codice Atlantico. Biblioteca Ambrosiana, Milan.
[11] Descendre, R. (2010) La biblioteca di Leonardo. Dans Atlante della letteratura italiana Vol. I, édité par Luzzatto, S. et Pedullà, G., pages 592–595. Einaudi Editore, Milan. https://shs.hal.science/halshs-00556737v1.
[12] Vecce, C. (2017) La biblioteca perduta : I libri di Leonardo. Salerno Editrice, Rome.
[13] Vecce, C. (réd.) (2021) La biblioteca di Leonardo. Giunti, Florence.
[14] Le Gall, J.-M. (2011) Un idéal masculin ? Barbes et moustaches (xve–xviiie siècles). Payot, Paris.
[15] Arrighi, V., Bellinazzi, A., et Villata, E. (réds.) (2005) Leonardo da Vinci. La vera immagine : Documenti e testimonianze sulla vita e sull’opera. Giunti, Florence.
[16] Lomazzo, G. P. (1974) Idea del tempio della pittura. Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Florence. (Publ. originale : Ponto, Milan, 1590 ; éd. par Klein, R.).
Pour citer cet article
A propos de : Laure Fagnart
Dépt. des sciences historiques, Université de Liège, B–4000 Liège, Belgique
Laure.Fagnart@uliege.be