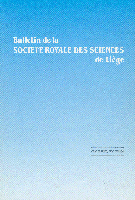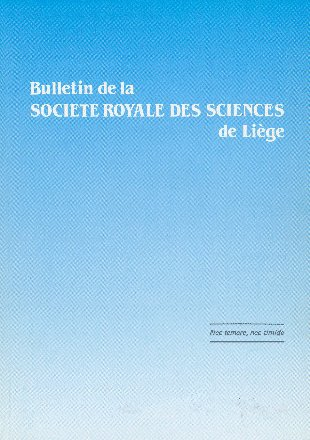- Startpagina tijdschrift
- Volume 94 - Année 2025
- No 2 - Colloque Annuel 2025: L'art au service de l...
- Colloque annuel 2025 de la Société Royale des Sciences de Liège :
L'art au service de la science, la science au service de l'art
Weergave(s): 195 (29 ULiège)
Download(s): 58 (3 ULiège)
Colloque annuel 2025 de la Société Royale des Sciences de Liège :
L'art au service de la science, la science au service de l'art

Documenten bij dit artikel
Version PDF originaleInhoudstafel
Manuscrit reçu le 23 novembre 2025 et accepté le 25 novembre 2025
Article publié selon les termes et conditions de la licence Creative Commons CC BY 4.0.
L'art au service de la science, la science au service de l'art
1L’art et la science sont souvent présentés comme deux mondes séparés : d’un côté, l’intuition, la sensibilité, l’émotion ; de l’autre, la rigueur, la méthode et la mesure. Pourtant, la réalité du travail scientifique montre chaque jour combien cette opposition est artificielle. Les scientifiques modernes sont bien obligés d’avoir une certaine veine artistique : pour donner à voir leurs résultats, ils doivent manier l’art littéraire afin de construire une histoire intelligible ; lorsqu’ils s’adressent au public, ils mobilisent l’art de la scène, de la rhétorique, de la mise en espace. De même, les artistes n’ont jamais cessé d’être des observateurs attentifs du monde, des expérimentateurs, des inventeurs de techniques. À travers l’histoire, leurs pratiques se sont souvent nourries d’un savoir profondément empirique—parfois même en avance sur la science constituée.
2Ce numéro spécial du Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège consacré au colloque 2025 sur « L’art au service de la science, la science au service de l’art » illustre la fécondité de ce dialogue. Les contributions réunies ici témoignent de la manière dont les disciplines se croisent, s’éclairent et s’enrichissent mutuellement, que l’on s’intéresse à l’orfèvrerie médiévale, à l’architecture carolingienne, aux tombes pharaoniques, à la gastronomie contemporaine, aux nanomatériaux ou encore aux courbes dessinées par des milliers de mains anonymes.
3Ainsi, Frédéric Hatert nous plonge dans l’étude des gemmes et de leurs imitations au cœur des objets d’orfèvrerie ancienne. L’analyse scientifique—discrète, non destructive, quasi invisible—permet de révéler ce que l’œil ne perçoit pas : l’origine des pierres, leurs transformations, les savoir-faire oubliés des artisans du passé. Ici, la science ne vient pas contredire l’art, elle en révèle la profondeur matérielle.
4Avec Line van Wersch, c’est l’architecture du haut Moyen Âge qui se dévoile sous l’éclairage des méthodes archéométriques : prospections géophysiques, datations radiocarbone, analyses élémentaires. Ces techniques redonnent corps à des édifices dont il ne reste parfois que des fragments. Elles recomposent non seulement les formes, mais aussi les temporalités et les gestes constructifs, permettant de restituer la créativité architecturale d’époques longtemps jugées obscures.
5Le projet Paint like an Egyptian, présenté par David Strivay, montre à quel point la technologie contemporaine peut dialoguer avec les chefs-d’œuvre de l’Égypte ancienne. Grâce à l’imagerie scientifique à haute résolution, à la spectroscopie portable et à la microscopie in situ, les peintures funéraires révèlent leurs pigments, leurs couches, leurs dégradations, et jusqu’à la main du peintre derrière les millénaires. La science déconstruit les strates qui composent ces œuvres d'art avec délicatesse, sans y toucher.
6L’universalité de Léonard de Vinci, évoquée par Laure Fagnart, nous rappelle que la séparation entre arts et sciences est récente. Autodidacte, Léonard est devenu un « omo universale » précisément parce qu’il n’a jamais reconnu de frontière entre observer, expérimenter, calculer, peindre ou rêver. Son exemple résonne encore aujourd’hui, plus de cinq cents ans après sa mort.
7Samuel Nicolay nous fait entrer dans un autre type de rencontre : celle entre mathématiques, statistiques et peinture. Comment quantifier une texture ? Comment reconnaître la signature d’un artiste à partir des irrégularités d’un coup de pinceau ? L’étude multifractale des toiles de van Gogh montre qu’un tableau peut être lu comme une structure mathématique, sans jamais perdre sa puissance expressive.
8La keynote de Jean-Marc Chomaz, Incipit Temporis, nous invite à réfléchir à la nature même du Temps—ce concept insaisissable que la physique tente de formaliser et que l’art rend sensible. Par une série d’installations artistiques, il montre comment la création peut saisir, mieux que bien des équations, nos intuitions de causalité, de réversibilité, d’irréversibilité. Ici, l’art devient un instrument conceptuel.
9Dans un registre très différent, Dorothée Goffin explore la gastronomie comme espace expérimental où s’entremêlent santé, cognition, durabilité, technique et culture. Pour le commun des gourmets, la gastronomie est un art à l’état gourmand ; pour elle, les plaisirs des fourneaux et de la table vont bien au-delà : la gastronomie est un véritable outil scientifique, un terrain d’investigation sur les comportements, les écosystèmes, les technologies et l’imaginaire alimentaire.
10Le projet présenté par Bruno Teheux nous montre comment des milliers de dessins récoltés lors d’événements publics peuvent devenir une matière première mathématique, puis musicale. Les interactions entre artistes, mathématicien·nes et le public renouvellent notre regard sur les mathématiques, trop souvent perçues comme abstraites ou froides. Par l’émotion qu’elles suscitent, ces collaborations réaffirment que science et sensibilité ne s’opposent pas : elles se complètent.
11Enfin, Ngoc Duy Nguyen nous plonge au cœur des laboratoires de nanomatériaux, où artistes et chercheurs ont mené des résidences croisées. Les nanostructures, invisibles à l’œil nu, deviennent artefacts visuels, sonores ou tactiles. En retour, les chercheurs trouvent dans ces échanges de nouvelles manières d’expliquer, de raconter, d’expérimenter. Lorsque les frontières tombent, les idées circulent.
12Dans toutes ces contributions, un fil rouge apparaît : la science gagne à s’ouvrir à l’art, tout comme l’art s’enrichit des avancées scientifiques. Ce sont deux manières d’interroger le réel, deux gestes complémentaires pour mieux comprendre le monde et ce que nous y devenons.
13Si les pages qui suivent arrivent à persuader nos lecteurs—scientifiques, artistes ou simple curieux—que l’exploration—qu’elle soit artistique ou scientifique—commence toujours par un même mouvement, celui de regarder, alors le colloque 2025 de la Société Royale des Sciences de Liège aura pleinement rempli nos attentes.
Remerciements
14GM est Chercheur qualifié du Fonds de la Recherche Scientifique–FNRS ; SD est Maître de recherches du Fonds de la Recherche Scientifique–FNRS. L’affiche du colloque reproduite en annexe a été réalisée par Sylvie Marchal (Service administratif de la Faculté des Sciences de l’Université de Liège) et nous la remercions très chaleureusement pour sa création.
Informations supplémentaires
Identifiants ORCID des auteurs
150009-0009-7310-3303 (Guy Munhoven)
160000-0002-9022-6948 (Stéphane Dorbolò)
Conflits d’intérêt
17GM est président 2025 de la Société Royale des Sciences de Liège et rédacteur en chef du Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège. SD déclare l’absence de conflits d’intérêts.

Affiche du Colloque 2025 de la SRSL : Création – Sylvie Marchal (ULiège) ; image de fond – Karl Blossfeldt (1928) Urformen der Kunst (Rijksmuseum, Amsterdam (NL), domaine public).
Om dit artikel te citeren:
L'art au service de la science, la science au service de l'art», Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège [En ligne], Volume 94 - Année 2025, No 2 - Colloque Annuel 2025: L'art au service de la science, la science au service de l'art, 1-4 URL : http://popups.ulg.be/0037-9565/index.php?id=12546.
Over : Guy Munhoven
Guy.Munhoven@uliege.be
Over : Stéphane Dorbolò
S.Dorbolo@uliege.be